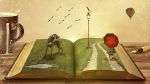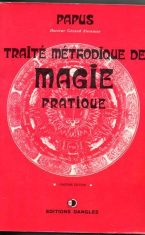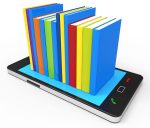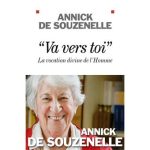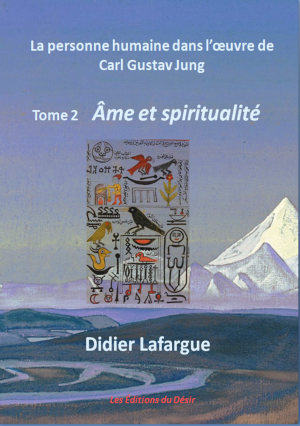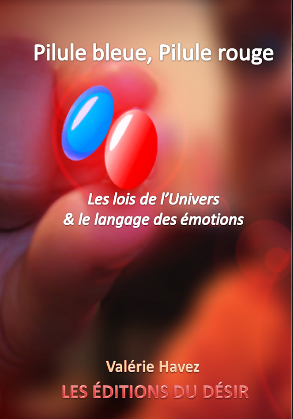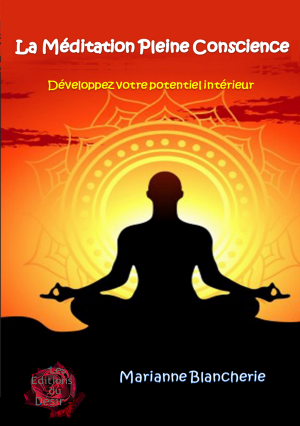Aux origines aussi, des approches, des cultures, des pratiques, qui ne sont pas d’habitude en lien avec la psychologie.
LES DOCTRINES DU THÉOSOPHISME ET DU NEW AGE
À la fin du XIXe siècle, différents courants de croyances quant au fonctionnement de l’esprit humain et de l’expérience humaine sont en concurrence dans l’idéologie populaire européenne, récemment libérée des dogmes religieux institutionnels et portée par la philosophie méthodique et relativiste des lumières. La psychologie expérimentale, qui s’inspire des méthodologies de la biologie, émerge progressivement via les travaux de Gustave Fechner (1801-1887), Wilhelm Wundt (1832-1920) et Théodule Ribot (1839-1916). Cette discipline ne pénètrera l’idéologie populaire qu’au milieu du XXe siècle par la diffusion des propositions conceptuelles de psychanalystes, telles que la notion d’inconscient de Sigmund Freud (1856-1939), ou de comportementalistes, telles que la notion de conditionnement d’Ivan Pavlov (1849-1936),
LES INFLUENCES CULTURELLES
(…) Ainsi émerge en Occident un « dualisme conscience-énergie », réunissant les courants autrefois nommés « spiritualistes » et « psychofluidistes », puis « spirites » et « magnétiseurs », où le corps humain possèderait un statut psychophysique qui se nommera bientôt « énergétique » ; et où l’esprit humain serait une partie d’une conscience au-delà de l’individuel, littéralement transpersonnelle, dotée de pouvoirs sur la matière, et permettant une relation dialogique avec des agents surnaturels. À partir des années 1920, cette doctrine est véhiculée par le new-age, qui se développe au travers de très nombreux ouvrages, et s’ancre dans l’imaginaire populaire occidental . Dans les années 1950, la culture américaine s’en empare, alors qu’il connaît un essor considérable dopé par le mouvement hippie des années 1960. Marque de son intégration au niveau socioculturel, la métaphysique conscience-énergie commence à être mobilisée comme une véritable épistémologie (au sens d’un cadre explicatif des phénomènes vécus). C’est-à-dire qu’elle va désormais servir, populairement, de base conceptuelle pour interpréter et appréhender de nombreuses expériences : personnelles, émotionnelles, familiales, motivationnelles, religieuses…
LES PHASES DE KEN WILBER
Il est l’un des fondateurs de la psychologie transpersonnelle, et a évolué vers la “Psychologie intégrale”. Il est connu pour son modèle de développement de la conscience selon 8 stades. Ces stades se répartissent selon 3 phases :
- Prépersonnelle : c’est le stade de l’enfant, marqué par l’égocentrisme tant dans ses relations interpersonnelles que dans ses processus cognitifs. Le Surmoi, représentant notamment l’intégration des normes sociales transmises par l’éducation, n’est pas encore suffisamment opérationnel. La conscience prépersonnelle agit librement au gré de ses pulsions, elle est donc potentiellement « déviante » du point de vue de la société. Ce stade est prédominé par les processus corporels ;
- Personnelle : c’est le stade de l’adulte qui a bien intégré les normes sociales du vivre ensemble (stade névrotique pour la psychanalyse). L’individu trouve son identité en lien avec le groupe social auquel il participe et y constitue un facteur de stabilité. Grâce au développement du mental, la conscience devient progressivement capable de se mettre à la place de l’autre, et de comprendre des points de vue différents du sien
- Transpersonnelle : c’est le stade où la conscience transcende à la fois le corps et le mental, prédominant dans les deux stades précédents, pour entrer dans un rapport au monde « vivant et immédiat », c’est-à-dire en dehors des catégorisations héritées du mental et de l’éducation. La conscience s’éveille ainsi progressivement au « monde de l’Esprit », invisible tant pour les yeux physiques que pour le mental. Du fait qu’il transcende les règles sociales, l’individu en conscience transpersonnelle est potentiellement perçu comme un élément subversif au sein de la société.
Ces trois phases correspondent donc à des modes de fonctionnement foncièrement différents • prépersonnelle personnelle —+ transpersonnelle prérationnelle -+ rationnelle -+ transrationnelle subconscient —+ conscience de soi -+ supraconscient…
L’EXPLORATION ET L’UTILISATION DE L’IMAGINAIRE
L’utilisation de l’imaginaire est très présente dans les techniques reliées à la psychothérapie transpersonnelle. Le phénoménologies et les comportements induits par l’activité imaginative autorisent à catégoriser les expériences mobilisant l’imaginaire comme des états modifiés de Conscience. En effet, ces expériences répondent bien au critère de « déviation de l’expérience subjective par rapport aux normes de l’individu Dans les cultures occidentales, les individus portent très rarement leur attention sur des contenus imaginaires activement stimulés, et l’utilisation active de l’imaginaire constitue pour eux une expérience subjective très inhabituelle et hors-norme. Par utilisation de l’imaginaire, nous entendons ici une expérience d’immersion complète de l’attention dans les représentations imaginales : non pas de simples évocations, mais de véritables perceptions de contenus imaginés, sous forme d’images (symboles, paysages, personnages), de sons (ambiances, dialogues), et de sensations physiques (intéroception, toucher, système vestibulaire). Il ne s’agit donc pas de « penser à » une situation imaginaire, mais bien imaginer activement les contenus et d’en expérimenter le vécu. L’imaginaire est alors vécu dans le corps, et apparait subjectivement comme véhiculé par les capteurs sensoriels, de manière très analogue à l’expérience du rêve. Cette caractéristique conduit Robert Desoille (1890-1966) à désigner ces expériences par le vocable “rêve éveillé”. Toutefois, à la différence du rêve, le sujet reste parfaitement conscient que l’expérience est imaginée, et il la différencie du monde sensible. (…) Ces expériences imaginales sont accessibles de manière étonnamment rapide, elles ne nécessitent que très peu d’entraînement pour être vécues de manière stable et profonde, et semblent se déployer de manière automatique dès qu’elles sont stimulées. Au XXe siècle, plusieurs chercheurs se sont intéressés à des techniques permettant d’explorer ainsi l’imaginaire.
(…) De notre observation, aujourd’hui seules quelques méthodes d’accompagnement utilisent, à des degrés divers, des techniques imaginales approfondies : psychothérapie transpersonnelle, psychosynthèse, hypnose, sophrologie, yoga nidra et néo-chamanisme. Toutefois, si les praticiens de ces méthodes mobilisent ces techniques et en observent des effets, les ressorts de celles-ci leur restent majoritairement inconnus. Les correspondances que nous avons indiquées entre phénoménologie imaginale, états de conscience spécifiques et affects spécifiques, incitent à approfondir la recherche dans ce domaine.
VERS LE DEVELOPPEMENT TRANSPERSONNEL
quand le développement personnel vise à révéler la singularité de l’individu au-delà des conditionnements du collectif, lui permettant ainsi de trouver et d’exprimer librement son plein potentiel (passage de la dépendance à l’indépendance), le développement transpersonnel serait l’ensemble des outils et des pratiques favorisant l’émergence et le déploiement de cette conscience transpersonnelle, holonique, simultanément individuelle et collective, singulière et universelle, formelle et (progressivement) subtile. En renforçant la conscience non pas du Moi (conscience prépersonnelle égocentrique), ni même du Je (conscience personnelle ethnocentrée voire mondo-centrée), mais celle du Nous (conscience transpersonnelle kosmocentrée qui transcende et inclut à la fois le Moi et le Je), le développement transpersonnel aiderait à libérer le potentiel des collectifs, qu’ils soient petits (une famille, une équipe) ou plus vastes (la société, l’humanité), voire interespèces (incluant les vivants humains et non humains). Tandis que le développement personnel a permis aux individus de se différencier en tant que cellule, unique, autonome et efficace, les pratiques de développement transpersonnel permettraient de (ré)intégrer la conscience-cellule individuelle au sein de la conscience-organe (groupe) à laquelle elle participe, elle-même intégrée dans la conscience-organisme (métagroupe) au sein de laquelle elle œuvre, et ainsi de suite.
DES PRATIQUES PSYCHOTHERAPEUTIQUES INTEGRATIVES
L’exemple de Johann Henry (l’interviewé) : alliant essentiellement inspirations psychanalytique, gestaltiste, transpersonnelle et intégrale. Son intérêt, tant dans ses recherches que dans sa pratique clinique, se porte tout particulièrement sur l’accompagnement de la délicate transition entre les stades de conscience dits « personnels » et les stades dits « transpersonnels ». À cette fin, il aime explorer, notamment dans les sessions de groupe qu’il anime, le potentiel d’alliance entre la respiration holotropique, la méditation, les pratiques corporelles et le psychodrame transpersonnel.
Celui de Muriel Rojas Zamudio : diplômée en Arts et Lettres (arts scéniques et plastiques), avant de s’orienter vers la psychanalyse puis la psychologie transpersonnelle. Elle se positionne en tant que praticienne dont le travail se nourrit d’apports multiréférentiels — auteurs et techniques que la clinique invite à (re)visiter —, c’est dans les médiations artistiques et l’art-thérapie éclairés par la psychanalyse qu’elle a finalement trouvé l’espace exploratoire lui permettant d’articuler ce qui fonde sa pratique : l’expression artistique comme forme de langage de l’imaginaire, la posture du thérapeute comme pivot de l’accompagnement, et le questionnement du vécu, passé ou présent, comme ouverture vers un au-delà du Moi (identité ontologique, inscription dans l’espèce humaine, sens de l’expérience humaine, etc.).
Cyrille Champagne : ses recherches questionnent les effets cognitifs et comportementaux des techniques et des grilles de lecture mobilisées par les différentes pratiques de l’accompagnement (thérapies, développement personnel, coaching…). En particulier, elles étudient les interactions entre attentes, expériences vécues, et interprétations de ces expériences. Cyrille Champagne enseigne sur ces thèmes, sous forme de conférences « Hypnologie », rediffusées en vidéo sur la chaîne YouTube de I’ARCHE. Il soutient une information publique quant aux aprioris culturels et quant aux finalités des différentes pratiques de l’accompagnement, et il défend l’intérêt d’une éducation à la psychologie, à la relation à autrui, et à une hygiène cognitive et émotionnelle.

 Un nouveau phénomène de bien-être et développement personnel : Mahorikatan®.
Un nouveau phénomène de bien-être et développement personnel : Mahorikatan®.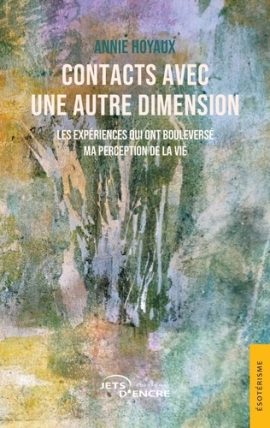 Annie Hoyaux, dans son ouvrage “Contacts avec une autre dimension”, se plonge dans un récit personnel et introspectif, explorant des expériences qui transcendent la compréhension ordinaire. Le choix des thèmes, empruntant à la fois au mystique et au quotidien, démontre une quête de sens et une volonté de partager des moments de vie qui ont profondément marqué l’auteur. La narration, fluide et ponctuée d’événements marquants – tels que “L’accident”, “La guérison”, “L’arbre de Furnes” – illustre une trajectoire personnelle empreinte de questionnements sur l’existence, la mort, et ce qui peut se trouver au-delà du tangible. Le style d’écriture, à la fois simple et chargé d’émotions, invite le lecteur à une réflexion sur les dimensions moins explorées de l’existence, poussant à envisager la vie sous un angle plus large. L’auteur semble chercher à éveiller une conscience chez le lecteur, à travers ses propres expériences extraordinaires, qui bien que personnelles, touchent à l’universel.
Annie Hoyaux, dans son ouvrage “Contacts avec une autre dimension”, se plonge dans un récit personnel et introspectif, explorant des expériences qui transcendent la compréhension ordinaire. Le choix des thèmes, empruntant à la fois au mystique et au quotidien, démontre une quête de sens et une volonté de partager des moments de vie qui ont profondément marqué l’auteur. La narration, fluide et ponctuée d’événements marquants – tels que “L’accident”, “La guérison”, “L’arbre de Furnes” – illustre une trajectoire personnelle empreinte de questionnements sur l’existence, la mort, et ce qui peut se trouver au-delà du tangible. Le style d’écriture, à la fois simple et chargé d’émotions, invite le lecteur à une réflexion sur les dimensions moins explorées de l’existence, poussant à envisager la vie sous un angle plus large. L’auteur semble chercher à éveiller une conscience chez le lecteur, à travers ses propres expériences extraordinaires, qui bien que personnelles, touchent à l’universel. Une petite histoire ?
Une petite histoire ? Le livre, désormais terminé, trouva sa place sur une étagère spéciale dans la bibliothèque d’Élise, non plus comme un simple récit, mais comme un compagnon de voyage dans sa propre exploration de l’extraordinaire.
Le livre, désormais terminé, trouva sa place sur une étagère spéciale dans la bibliothèque d’Élise, non plus comme un simple récit, mais comme un compagnon de voyage dans sa propre exploration de l’extraordinaire.
 Hazer Marie Volk nous mène dans une exploration profonde de l’identité, de la spiritualité, de la culture et de la psychologie humaine. Et nous exhorte : “Réveillez votre lien au vivant”.
Hazer Marie Volk nous mène dans une exploration profonde de l’identité, de la spiritualité, de la culture et de la psychologie humaine. Et nous exhorte : “Réveillez votre lien au vivant”.







 L’étude des phénomènes insaisissables à travers la phénoménologie : Un regard scientifique
L’étude des phénomènes insaisissables à travers la phénoménologie : Un regard scientifique Sous la direction de Bernard Etchelecou, Collectif Dunod
Sous la direction de Bernard Etchelecou, Collectif Dunod Alain DELOURME a écrit un livre profond qui nous fait monter, vibrer en spiritualité.
Alain DELOURME a écrit un livre profond qui nous fait monter, vibrer en spiritualité.